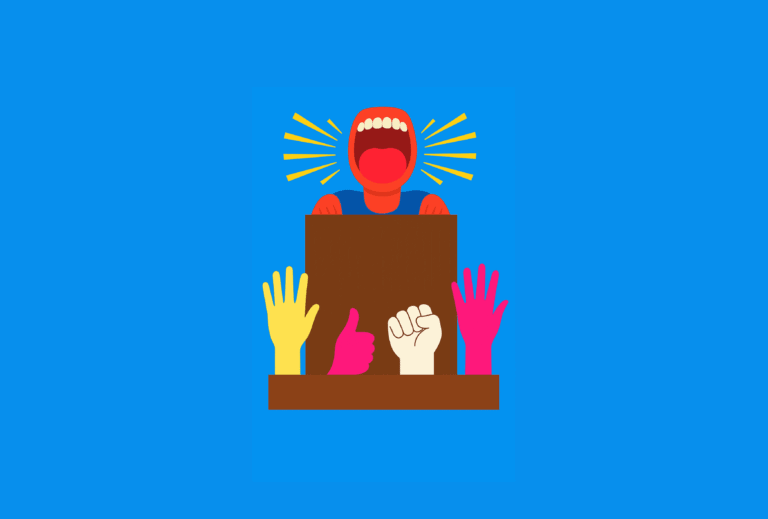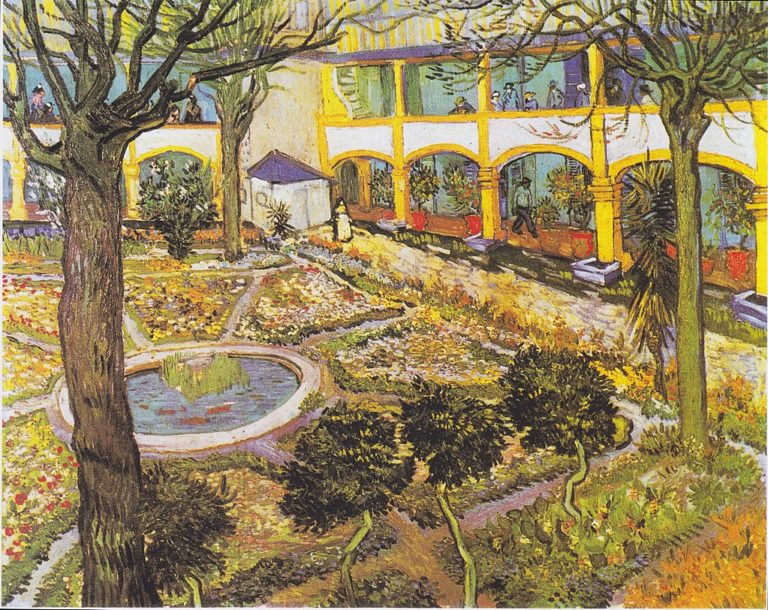L’avenir se joue dans la fidélité patiente de communautés qui veillent sur ce qui leur est confié

La COP30, tenue à Belém aux portes de l’Amazonie, laisse une impression mêlée : un accord a bien été signé, mais un accord étroit, qui contourne encore les décisions cruciales sur les combustibles fossiles et la déforestation. Dix ans après Laudato si’, le contraste demeure saisissant entre l’urgence que les sciences du climat mettent au jour et la lenteur avec laquelle nos choix collectifs s’y ajustent. Les appels que le pape François avait formulés en faveur d’une responsabilité commune réapparaissent aujourd’hui comme une référence forte. Certains en portent le poids avec inquiétude, parfois jusqu’à l’éco-anxiété ; d’autres s’en protègent par un cynisme tranquille, où l’on préfère ne rien voir pour ne rien changer.
Dans un tout autre registre, à quelques rues seulement, le Sommet des peuples pour la justice climatique offrait une tonalité plus dense et plus humaine. Des voix venues des rives des fleuves, des forêts et des quartiers populaires se répondaient : communautés autochtones, associations, jeunes militants, Églises. On y parlait avec simplicité des terres blessées et des liens tissés pour les relever. Dans ses prises de parole récentes, le pape Léon XIV met justement en lumière cette source d’espérance : ce sont souvent les communautés les plus exposées qui ouvrent des chemins neufs, refusant de céder à la lassitude et inventant des formes concrètes de soin.
Ces initiatives locales ne suffisent pas à elles seules, mais elles rappellent que toute conversion écologique naît dans des lieux précis, là où des personnes acceptent de porter ensemble la fragilité d’un territoire. L’héritage du pape François, relisant la création comme un don partagé, rejoint ici l’insistance du pape Léon XIV sur un engagement qui allie lucidité, justice et persévérance. Ces deux voix, désormais complémentaires, invitent à dépasser à la fois l’angoisse qui paralyse et l’indifférence qui endort.
Belém laisse ainsi entrevoir une vérité simple : l’avenir ne se joue pas seulement dans les grandes enceintes diplomatiques, mais dans la fidélité patiente de communautés qui choisissent de veiller sur ce qui leur est confié. C’est là que peut naître une espérance solide, enracinée dans le réel.
Éric CHARMETANT
Doyen de la Faculté de philosophie