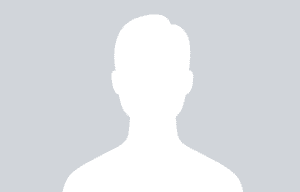Manuscrits, archéologie et philosophie en Chine ancienne

I. Le Laozi en dialogue
Nous commencerons par une étude approfondie du sens de wu 無 dans le Laozi : Quel rapport au you有 ? A-t-on besoin des notions de (non)-être pour traduire ces deux termes ? Ensuite, bâtissant sur des thèmes abordés lors du colloque « Dieu et le Dao », nous mettrons wu en dialogue avec la vision séfirotique de Dieu et de la théologie négative du pseudo-Denys l’Aréopagite et du maître Eckhart.
II. Les manuscrits philosophiques et littéraires du pays de Chu (4ème et 3ème siècles av. n. è.)
Cette série de conférences a pour objet les manuscrits philosophiques et littéraires de l’époque des Royaumes combattants (481-221 av. n. è.), qui furent exhumés au cours des dernières décennies dans des tombes de l’ancien royaume de Chu. La grande majorité du contenu de ces manuscrits n’a pas été transmis par la tradition lettrée, éclairant ainsi d’un jour nouveau l’histoire intellectuelle de la Chine ancienne. Après une séance introductive consacrée au contexte de découverte et aux spécificités de ces manuscrits sur fiches de bambou, nous présenterons les principaux corpus découverts à ce jour et commenterons plusieurs passages extraits de ces écrits inédits.
III. L’archéologie de la religion antique de la Chine
- Approche archéologique de la religion au Deuxième millénaire
- L’évolution des modes de sépulture sous les Zhou (env. 1050-256 av. J.-C.)
- La question de la réforme du rituel au IXe siècle avant notre ère
- Dieux, esprits et démons dans le royaume de Chu (VIe – IIIe s. av. J.-C.)
Si l’on ne se basait que sur les textes de l’antiquité pré-impériale transmis par la tradition lettrée, ceux considérés comme antérieurs à 221 av. J.-C., nous ne saurions pas grand-chose sur la religion chinoise ancienne. Celle-ci ne commence à être bien documentée qu’à partir de l’époque des Han (206 av. J.-C.-220 de notre ère) en raison de l’abondance des textes qui s’y rapportent directement ou indirectement. Depuis la fin du XIXe siècle, l’archéologie a, quant à elle, révélé sur la religion des dynasties Shang (env. 1500-1050 av. J.-C.) et Zhou (env. 1050-256 av. J.-C.) quantité d’aspects jusqu’alors méconnus : que l’on songe par exemple à la divination des rois Shang lors de la dernière phase de leur dynastie (phase d’Anyang, env. 1300-1050 av. J.-C.), ou à l’apport considérable de la fouille des cimetières du royaume de Chu, dans le centre-sud de la Chine. C’est essentiellement grâce à l’archéologie funéraire que l’on peut comprendre les formes prises par le culte des ancêtres chez les élites, et le rôle fondamental de ce culte dans l’exercice de leur pouvoir. Sur la longue durée, il est désormais permis de retracer l’évolution des croyances dans l’au-delà.
IV. Eléments de philosophie du rituel dans le Traité des Rites
Le corpus des textes rituels en Chine ancienne comprend à la fois des prescriptions, des descriptions et une philosophie du rituel. Il ne s’agit pas seulement d’un catalogue des rites et des règles à suivre. Dès la dynastie des Han occidentaux 西漢 (206 av. J.-C.-9 apr. J.-C.) sont rassemblés et édités plusieurs corpus de textes rituels, parmi lesquels le Traité des rites (Liji 禮記) qui développe une réflexion sur la signification de diverses pratiques rituelles.
Ces séances exploreront, à travers la lecture précise de passages choisis du Traité des rites, divers éléments autour desquels s’articule une philosophie du rituel : le rôle central des sensations, la formalisation par les nombres, et enfin le changement à l’œuvre dans le rituel.
V. Léon Wieger et sa lecture du Zhuangzi. Portraits Jésuites de Chen Duxiu
À la fin du XIXᵉ siècle, l’approche jésuite des traditions chinoises se transforme sous l’effet conjugué de l’essor des sciences humaines, de l’influence de l’herméneutique protestante, du néo-thomisme et du renouveau des études bibliques et patristiques. Ces évolutions redéfinissent la place de la sinologie missionnaire, sans pour autant modifier ses orientations majeures : l’étude des textes classiques dans la longue durée et l’analyse de la Chine contemporaine. Ces présentations examineront deux exemples illustrant ce double mouvement, à la croisée de la sinologie académique naissante et du repositionnement missionnaire en s’intéressant à la vie et l’œuvre de Léon Wieger et aux différentes perceptions de Chen Duxiu, fondateur du parti communiste chinois.
Avec ces enseignant(e)s :
60 % jeunes de moins de 30 ans
30 % demandeurs d’emploi
20% deux personnes composant le couple
(un justificatif pourra être demandé)